La généalogie situationnelle
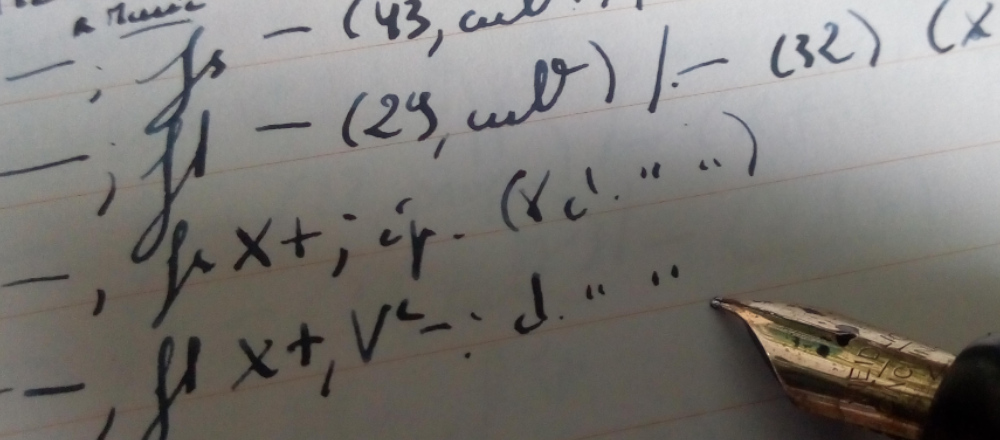 © Paul Gossart
© Paul Gossart
Introduction à un esprit de travail
« Que peut-on savoir d’un homme aujourd’hui ? Il m’a paru qu’on ne pouvait répondre à cette question que par l’étude d’un cas concret (…). Cela revient à totaliser les informations dont nous disposons sur lui. Rien ne prouve, au départ, que cette totalisation soit possible et que la vérité d’une personne ne soit pas plurale » (SARTRE Jean-Paul, L’idiot de la famille, t.1, p. 7).
Ainsi Sartre débute-t-il son dernier ouvrage. Si la question est plutôt bien posée par rapport à ses limites, elle n’est pas — ou mal — justifiée. Pourquoi chercher un tel savoir ? Ce flou intellectuel se ressent dans le développement de la question. L’auteur choisit Flaubert parce qu’il a un « vieux compte à régler avec lui » (Ibid., p. 8), parce qu’il en a lu la correspondance, parce que les informations auxquelles il a eu accès ont éveillé sa curiosité. Sartre se trompe complètement sur ce choix : « qui » est Flaubert ? Non pas « qui » au sens de son être réel et concret, mais « qui », en général, par rapport à la question qui est posée ? Il est le pire sujet d’étude que l’on puisse choisir, car il efface les implications concrètes et donc historiques de la question. Celui qui se demande « que peut-on savoir d’un homme aujourd’hui » se le demande dans une situation où ce savoir concret manque. Le cas Flaubert ne correspond à personne : qui peut se vanter d’avoir la correspondance et les émois intimes de Joseph Dubart, ouvrier mineur à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) en 1870 ? Pourtant, ce Joseph Dubart est bien l’homme qui est visé par cette question. Son existence est toute bureaucratique : à quelque technique près, cet homme c’est l’homme d’aujourd’hui. Mais j’irai plus loin encore : « que peut-on savoir d’un homme aujourd’hui — dont on sait peu de choses ? » n’est pas suffisant. Il est exact de constater que « les renseignements sont fort différents de nature » et que nous risquons « d’aboutir à des couches de significations hétérogènes et irréductibles » (Ibid., p. 7). On pourrait arriver, par naïveté, à la conclusion que depuis plus de deux siècles, la rationalisation et le développement des techniques d’informations augmente la quantité et la variété d’informations disponibles sur un individu. Bien au contraire, notre siècle est celui de la destruction des situations particulières. Le développement de cette rationalité et de cette technique a mis en péril l’existence individuelle et avec elle l’existence en général. Se poser la question devient justifié dans la précision suivante : « que peut-on savoir d’un homme aujourd’hui — dont on ne sait plus rien ? ».
Car cet homme dont il ne reste rien est une possibilité déjà réalisée. L’individu anéanti dans le système d’extermination nazi est déchu progressivement de sa concrétude : disparu de l’espace social et humain dans un premier temps, il est massé puis transporté dans un univers où il ne signifie plus rien et où lui-même ne parvient plus à se situer autrement que par cet univers fermé et réducteur. L’aboutissement de cette réduction individuelle n’est pas simplement la mort ; la mort est une trace : « on entre dans un mort comme dans un moulin » (Ibid., p. 8). La porte de cette existence n’est pas fermée : elle disparaît de manière à n’avoir jamais existé. L’extermination est un processus de destruction caractérisé par la disparition de la disparition. Parmi les morts de Birkenau, de Chelmno, de Jasenovac, ou de Treblinka, il en est dont on ne sait rien. Chiffre d’une comptabilité, dont le souvenir a disparu avec la famille les voisins et les objets, l’existence dans les muselmänner et dans les cendres, la mort — et donc l’existence possible aux yeux d’un tiers qui en viendrait à la découvrir — dans la disparition des traces de la destruction.
On me répondra qu’il est encore bon nombre d’hommes qui vivent paisiblement les petits aléas de la vie quotidienne, et que les disparitions font toujours l’objet de deuils. C’est un point de vue très occidental. Combien de disparitions de la disparition dans les déplacements, les guerres et les cimetières marins dans lesquels s’engloutissent les progrès de la civilisation industrielle ?
Rechercher les hommes concrets du passé aujourd’hui est donc tout près de la critique de notre temps. La discipline qui s’occupe de cela, c’est la généalogie situationnelle : et pas la « généalogie » en général.
Du point de vue historique et situationnel qui est le notre, la généalogie se montre comme une pratique essentiellement médiée par une technique, doublée d’une existence sociale sur le mode du loisir, de l’objet de consommation. L’homme qui n’a plus de sens est invité à en consommer dans le marché généalogique ; mais comme toute accumulation marchande, cette voie est une impasse. Jusqu’où l’impérialisme du loisir généalogique pourra-t-il aller ? Son propre consommateur, vidé de ses significations, ne pourra guère l’alimenter davantage. Ainsi la généalogie disparaîtra avec les derniers lambeaux d’hommes dans les derniers instants de l’histoire.
La généalogie situationnelle est donc la seule voie vivante : elle ne vise pas à l’accumulation technicienne. Elle mène l’individu à la réinterprétation des éléments de la vie quotidienne, en particulier le lieu de vie, ce qu’il reste de famille mais surtout la disparition des situations particulières. L’individu ne peut alors continuer sa recherche que dehors et, puisque ce dehors est sans cesse plus fantomatique, en le repeuplant de significations concrètes — si cela est possible. Puisqu’elle remet en cause le mouvement de destruction des situations caractéristique de notre époque, la généalogie situationnelle prend un sens révolutionnaire.